Chers amis,
J’abandonne (provisoirement) les vaccins, le Covid-19 et la philosophie pour revenir à Dame Nature.
Dans ce vaste jardin, je vais extraire 18 plantes incontournables et en décrire les bienfaits.
L’achillée millefeuille
Il est des plantes qui accompagnent l’homme depuis la nuit des temps. C’est le cas de l’achillée, véritable incontournable de la pharmacie familiale naturelle.
Aucune plaie ne lui résiste, pas même celles des guerriers antiques.
Vous connaissez sans doute l’histoire d’Achille, héros légendaire de la guerre de Troie. Quand il fut blessé au cours d’une bataille, il se souvint du pouvoir cicatrisant de la plante et l’utilisa comme remède. C’est ainsi qu’il eut la vie sauve et qu’en retour, il lui offrit son nom.
Il suffit de se glisser une feuille d’achillée roulée en boule dans la narine pour stopper un saignement de nez. En effet, le suc extrait de la plante fraîche renferme un antiseptique, un anti-inflammatoire, un cicatrisant et un hémostatique. Il contribue à la guérison des plaies, ulcères, crevasses, gerçures et hémorroïdes depuis des générations.
Sans doute même depuis des millénaires, car des paléontologues ont retrouvé des restes d’achillée aux côtés des squelettes d’hommes de Néandertal dans la fameuse tombe aux fleurs de la grotte préhistorique de Shanidar en Irak.
En infusion ou en teinture-mère pour les femmes :
L’achillée millefeuille n’est pas seulement la fidèle compagne des ouvriers ou des soldats, c’est aussi une précieuse alliée des femmes par son action régulatrice du cycle menstruel.
Tout d’abord, elle calme les règles douloureuses grâce à ses propriétés antispasmodiques.
D’autre part, elle contribue au retour des menstruations lorsque celles-ci ont été interrompues par un choc émotionnel, un refroidissement ou une anémie par exemple.
Enfin, elle rétablit l’équilibre entre progestérone et œstrogènes en cas d’excès de ces derniers, grâce à sa teneur en apigénine, molécule bloquant une étape de la chaîne de fabrication des œstrogènes.
Cerise sur le gâteau, son action sur la circulation veineuse permet même d’atténuer les varices et les troubles circulatoires de la ménopause, comme les jambes lourdes ou les bouffées de chaleur. Pour toutes ces indications, il vous suffit d’employer l’infusion de fleurs ou la teinture-mère de plante entière que vous trouverez en pharmacie. La bardane
La bardane
Si vous croisez la route de la grande bardane, vous ne pourrez pas manquer de la remarquer car ses capitules floraux auront tôt fait de s’accrocher à vos vêtements.
Qui ne s’est amusé, étant enfant, à lancer ces fabuleuses fléchettes végétales dans le dos des copains ?
Mais la bardane peut être employée à bien meilleur escient que comme projectile : c’est une grande plante dépurative qui a tant de vertus qu’on lui a donné le nom de guérit-tout.
Elle est même à l’origine d’une invention célèbre dans le monde entier…
George de Mestral fut étonné par l’ingéniosité de ces crochets qui s’agrippent aux poils des animaux ou aux mailles des tissus pour ne plus en partir, même quand on les en décroche. Il ne lui en fallait pas plus pour inventer la fixation amovible crochets boucles textiles, plus connue de nos jours sous le nom de la marque qui la commercialisa : Velcro !
En cure détox :
La bardane est une remarquable draineuse du sang, qui le débarrasse de ses déchets (cholestérol, urée). Elle augmente la sécrétion urinaire (diurétique), provoque la transpiration (sudorifique), et booste la production de bile par le foie (cholérétique) et stimule son excrétion par la vésicule biliaire (cholagogue).
Voilà une détoxination multifonctions parfaite pour les cures détox des lendemains de fête.
Mais elle est aussi et surtout indiquée en cas de constipation urinaire, de fièvre éruptive (varicelle, rougeole, rubéole, etc.), de calculs urinaires ou biliaires, de goutte, d’arthrite, de rhumatismes, d’autismes ou plus globalement pour drainer.
À cela s’ajoutent de précieux effets anti-inflammatoires.
De plus, elle possède des propriétés hypoglycémiantes qui en font une plante intéressante en cas de diabète.
En décoction pour les affections cutanées :
Les qualités dépuratives, anti-inflammatoires et antibactériennes de la bardane en font un excellent remède contre les affections cutanées chroniques.
En nettoyant votre organisme de l’intérieur, elle vous évite de bourgeonner à l’extérieur ! En effet, lorsque les organes d’élimination comme le foie ou les reins sont dépassés, c’est souvent la peau qui prend le relais. La bardane va les drainer avant que les déchets ne débordent au niveau cutané. Elle se montre efficace contre les abcès, les furoncles, l’acné, l’eczéma ou le psoriasis..
En complément de la cure interne (décoction ou teinture-mère par voie orale), vous pouvez également appliquer la plante en externe sur les lésions cutanées. Pour cela, réalisez une décoction plus concentrée à hauteur de 100 g de racine fraîche par litre d’eau. Il est aussi possible de broyer la racine ou les feuilles fraîches et d’appliquer directement la pulpe.
On employait même autrefois le suc frais de la plante contre les piqûres de guêpes et les morsures de serpent en raison de son pouvoir antivenimeux. Les feuilles ont des propriétés désinfectantes, antifongiques et cicatrisantes, mais elles doivent être employées fraîches car elles perdent leurs principes actifs au séchage.
Vous pouvez les appliquer en cataplasmes sur les rhumatismes, en les enveloppant dans des compresses douloureuses : faites-les simplement chauffer à la vapeur.
En décoction pour son action antibactérienne :
Mais ce n’est pas tout, la bardane est aussi une excellente antibactérienne qui s’attaque notamment au staphylocoque doré, au streptocoque, au pneumocoque, à la bactérie Escherichia coli ou encore au bacille Pseudomonas aeruginosa.
Pour toutes ces indications, c’est la racine qu’il vous faut utiliser de préférence fraîche car elle est plus active que sèche.
Si vous disposez de la plante dans votre jardin, vous pouvez préparer une décoction à raison de 50 g de racine par litre d’eau. Coupez-la en petits morceaux et mettez-les dans l’eau froide, portez à ébullition, laissez bouillir à feu doux pendant 20 minutes puis laissez infuser 10 minutes, filtrez et buvez 3 tasses par jour pendant 2 semaines.
Sinon, vous avez la possibilité de vous procurer en pharmacie de la teinture-mère réalisée à partir de racine fraîche de bardane.
Le calendula
Voilà une plante qui gagne à être cultivée, car dans la nature le calendula se fait désirer.
Son espèce sauvage, le souci des champs, pousse dans les vignes, les friches et les talus du sud et du centre de la France, mais ailleurs il se montre rare. En revanche, son espèce cultivée, le souci des jardins, vous récompense d’une abondance de fleurs et de bienfaits dès que vous l’installez dans votre potager.
Grâce à lui, finis les soucis cutanés : il guérit tous types de plaies !
Le calendula s’avère principalement une plante de la peau. C’est même l’une des meilleures vulnéraires de notre flore. Non seulement le souci fait cicatriser les plaies, mais il les désinfecte, éliminant virus, champignons et bactéries, dont le staphylocoque doré responsable de nombreuses infections cutanées.
Vous pouvez mettre à profit ses propriétés cicatrisantes, antiseptiques et anti-inflammatoires en cas d’égratignure, de brûlure, de coup de soleil, d’engelure, de piqûre d’insecte, d’ulcère, d’eczéma, d’érythème ou d’acné.
Calmant et adoucissant, il répare à merveille les peaux sèches ou irritées.
Les chercheurs ont notamment identifié parmi ses composants des saponines cicatrisantes, anti-inflammatoires et antiseptiques, des mucilages émollients et adoucissants, de l’acide salicylique analgésique, une huile essentielle antibactérienne et des flavonoïdes antioxydants.
De plus, c’est une excellente plante auxiliaire qui repousse les nématodes, la teigne du poireau et la piéride du chou, tout en attirant les insectes utiles tels que les coccinelles, les punaises prédatrices d’acariens et de mouches blanches et les syrphes pollinisateurs. N’hésitez pas à l’installer près de vos fraisiers, poireaux, pommes de terre, choux, haricots, tomates et rosiers.
Le souci est une plante solaire par excellence : son nom vient du latin sol sequi signifiant littéralement « qui suit le soleil », car ses fleurs s’ouvrent et se ferment en fonction de l’ensoleillement, comme le tournesol.
Ce petit soleil ornera à merveille vos plates-bandes, mais aussi vos salades et vos desserts. Ses fleurs sont comestibles et étaient même autrefois utilisées pour colorer le beurre.
En teinture pour les plaies et les inflammations cutanées :
Pour réaliser votre teinture de calendula, faites macérer pendant 10 jours 50 g de fleurs séchées dans 250 g d’alcool à 60°, filtrez et conservez dans un flacon en verre teinté.
Comme la décoction, on l’emploie pour désinfecter les plaies et traiter les inflammations cutanées. Mais vu qu’elle contient beaucoup d’alcool, mieux vaut la diluer avant de l’appliquer, à raison d’une cuillerée à café dans 3 cuillerées à soupe d’eau. La camomille
La camomille
Vous prendrez bien une camomille ?
Cette plante nous est devenue si familière qu’elle est presque désormais synonyme de tisane. Certains l’adorent pour sa saveur unique, d’autres la détestent en raison de souvenirs amers.
Mais ce qui est sûr, c’est que nous avons tous goûté dans notre enfance à cette grande classique de la phytothérapie familiale.
Vous vous rappelez ? C’est une incontournable des problèmes digestifs, des conjonctivites et des maux de tête en particulier.
Il existe tout un éventail d’espèces de camomille, mais les plus fréquemment cultivées sont la camomille matricaire (Matricaria chamomilla L.) et la camomille romaine (Chamaemelum nobile (L.) All.).
- La camomille matricaire pousse spontanément au milieu de nos cultures, sur le bord des chemins ou dans les terrains vagues, souvent sur des sols compactés. Ses fleurs et feuilles ont un parfum prononcé évoquant celui de la pomme.
- La camomille romaine quant à elle n’a rien à voir avec Rome car elle pousse naturellement sur le littoral atlantique.
Les camomilles matricaire ou romaine possèdent toutes deux les mêmes vertus phytothérapeutiques, donc il ne vous reste plus qu’à choisir selon vos goûts !
C’est surtout pour leurs qualités digestives que les camomilles sont réputées, et à juste titre : leur infusion ouvre l’appétit, facilite la digestion, régule la constipation comme la diarrhée, apaise les spasmes intestinaux, stoppe les vomissements nerveux et stimule la vésicule biliaire.
On a l’habitude de la boire après les repas, mais c’est une erreur : mieux vaut la prendre avant pour déclencher la sécrétion des sucs digestifs et préparer le système à recevoir les aliments.
En infusion :
Recette detisane de camomillepour améliorer la digestion :
Mettez une cuillère à dessert de fleurs séchées dans 150 ml d’eau froide, portez à frémissement, retirez du feu et laissez infuser 10 minutes à couvert. Filtrez et buvez une demi-heure à un quart d’heure avant le repas.
Ses effets antispasmodiques et analgésiques ne s’exercent pas seulement sur les spasmes digestifs mais aussi sur les névralgies, notamment faciales, les migraines et les douleurs fébriles des grippes.
On la prend alors à distance des repas pour un effet plus fort. Pour ces pathologies, on peut aussi employer la poudre de fleurs séchées, à raison de 4 g par jour, soit sous forme de cachets achetés en pharmacie, soit finement broyée au mortier et intégrée à de la confiture.
Recette d’infusion pour lutter contre la fièvre :
Mettez 5 à 10 g de fleurs séchées dans 1 l d’eau froide, portez à ébullition, retirez du feu et laissez infuser 1 h. Filtrez et buvez 2 à 3 tasses par jour. Si vous trouvez ce breuvage trop amer, ajoutez pour l’adoucir quelques morceaux de racine de réglisse ou graines d’anis vert à vos fleurs de camomille.
En infusion pour divers usages :
L’usage externe, l’infusion concentrée de camomille donne de très bons résultats dans le traitement des plaies, des ulcères, des panaris et des inflammations en général.
Vous pouvez par exemple l’appliquer sur la peau pour calmer les coups de soleil et les gerçures ou en faire un bain de bouche pour soigner les aphtes et petites plaies buccales. Elle sert aussi à éclaircir et redonner de jolis reflets aux cheveux blonds.
Pour cela, comptez 50 à 100 g de fleurs séchées par litre d’eau et laissez infuser 30 minutes. Vous pouvez même l’intégrer à l’eau de votre bain pour adoucir votre peau, calmer les démangeaisons (notamment en cas d’eczéma) et soulager les éventuels rhumatismes. Les bains de camomille étaient traditionnellement employés pour revigorer les personnes affaiblies et les enfants malades.
Enfin, l’utilisation de cette plante contre les conjonctivites et inflammations des paupières est bien connue. Dans ce cas, comptez 10 g de fleurs séchées par litre d’eau et filtrez minutieusement à travers un tissu fin pour éviter le passage d’éventuels poils irritants, puis appliquez à l’aide d’une compresse sur la paupière fermée.
Son infusion soulage aussi les douleurs menstruelles, à raison d’une cuillerée à soupe de fleurs séchées par tasse, 2 à 3 fois par jour. Elle apaise également les maux de tête liés aux menstruations, mais pas seulement : c’est une plante souveraine pour tous les types de migraine.
En huile de massage :
Pour soulager vos rhumatismes, douleurs de la goutte, sciatiques, foulures ou entorses, faites chauffer pendant 2 heures au bain-marie 50 g de fleurs fraîches de camomille dans un demi-litre d’huile d’olive bio, vierge, de préférence pressée à froid. Filtrez, laissez refroidir, puis appliquez cette huile très utile au parfum camphré en massage sur les zones douloureuses.
Ce sont toutes deux des plantes emménagogues qui déclenchent les règles, notamment en cas d’absence d’origine nerveuse ou atonique. À éviter donc en début de grossesse : la camomille s’avère abortive à forte dose.
En infusion et en teinture-mère pour arrêter de fumer :
La camomille romaine vient à votre secours si vous faites une cure de désintoxication, notamment du tabac.
Prenez une infusion le matin à jeun et 2 gouttes de teinture-mère quand vous avez envie d’allumer une cigarette.

La lavande
Elle était déjà utilisée dans l’Antiquité pour parfumer le linge et l’eau du bain des Romains.
À vrai dire, on a tellement l’habitude de sentir son parfum dans nos savons et nos lessives qu’on pourrait presque en oublier son pouvoir thérapeutique.
Pourtant la lavande est une puissante médicinale, à condition seulement de l’employer à bon escient. Pour cela, il vous faudra savoir différencier ses espèces. C’est parti pour un voyage botanique au cœur de la garrigue !
Dans l’imaginaire collectif, la lavande ce sont ces champs du sud de la France qui étalent leurs plates-bandes violettes à perte de vue comme dans les publicités de lessive. Sauf que sur ces belles images, ce n’est généralement pas de la lavande vraie qui vous est présentée, mais du lavandin ! Et c’est d’ailleurs lui que les lessiviers ont adopté, en raison de sa rentabilité.
La lavande vraie
L’huile essentielle de lavande officinale est depuis employée pour apaiser et réparer le tissu cutané.
Elle est à la fois antiseptique, antitoxique, anti-inflammatoire, antalgique et cicatrisante. Vous pouvez l’utiliser en cas d’égratignure, d’amourelle, de brûlure, de prurit, d’eczéma, d’ulcère, d’escarre, de mycose de l’ongle ou de coupure. Diluée entre 5 % et 10 % dans une huile de massage, elle soulagera également les tensions musculaires, crampes, douleurs nerveuses, sciatiques, rhumatismes, tendinites et foulures.
Et ce n’est pas tout ! L’huile essentielle de lavande vraie est un véritable anxiolytique naturel. Sa teneur en linalol et en acétate de linalyle lui confère des propriétés apaisantes, antidépresseives et antispasmodiques. Elle est donc tout indiquée pour les troubles d’origine nerveuse comme l’insomnie, l’irritabilité, le stress, la spasmophilie, la migraine ou encore les vertiges.
N’hésitez pas pour cela à l’employer en olfaction, grâce à un diffuseur ou en plaçant une goutte sur votre oreiller.
En infusion pour de multiples bienfaits :
Il n’y a pas que l’aromathérapie : vous pouvez aussi bénéficier des propriétés apaisantes, calmantes et sédatives de la lavande vraie avec une simple infusion. D’ailleurs, elle est tellement puissante que si vous dépassez la dose, elle risque au contraire de devenir excitante !
Comptez donc une cuillerée à café de fleurs séchées pour 25 cl d’eau froide, portez à frémissement puis laissez infuser 8 minutes à couvert. Vous pouvez boire jusqu’à 3 ou 4 tasses par jour.
Avant le coucher, cette infusion favorise l’endormissement. Après les repas, ses vertus stomachiques et antispasmodiques facilitent la digestion.
Elle s’emploie aussi contre la migraine, d’autant plus si celle-ci est d’origine digestive. Enfin, du fait de propriétés antiseptiques et sudorifiques de la plante, cette tisane est indiquée en cas de maladie infectieuse (grippe, bronchite, fièvre éruptive…).
La lavande aspic
La lavande aspic a sans doute été nommée ainsi par nos ancêtres parce qu’ils lui prêtaient le pouvoir de soigner les morsures de serpents. Ce qui est sûr, c’est que son huile essentielle apaise efficacement les piqûres d’insectes ou de méduses, les brûlures et les coups de soleil, en procurant une sensation de rafraîchissement immédiate.
Contrairement à la lavande officinale, son essence contient peu d’acétate de linalyle et de linalol et ne présente donc pas les mêmes effets apaisants et sédatifs. En revanche, elle est riche en camphre, ce qui en fait un excellent décontractant musculaire et un anti-inflammatoire bénéfique contre les douleurs articulaires et les tendinites. Pour cet usage, diluez-la à 5 % maximum dans une huile de massage.
Mais cette teneur en camphre implique quelques précautions d’utilisation. L’huile essentielle de lavande aspic est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu’aux enfants de moins de 8 ans.
Abstenez-vous de l’employer en olfaction ou en diffusion : contentez-vous d’une application cutanée sur la zone à traiter et diluez-la dès qu’il s’agit d’une surface de peau étendue.
Le lavandin
Le lavandin est un hybride des lavandes aspic et officinale, il a hérité des propriétés de ces deux espèces. Mais selon les plants, les caractères de l’une ou de l’autre prédominent. Sous l’appellation lavandin se cache en fait un mix de divers hybrides.
Pour connaître les propriétés d’une huile essentielle de lavandin, il vous faudra vérifier son chémotype, c’est-à-dire ses principaux composants chimiques. Le lavandin super est celui qui se rapproche le plus de la lavande officinale.
C’est notamment un répulsif efficace contre les poux, les mites et les moustiques.
Mais c’est surtout une plante très rentable à distiller : il faut compter seulement 40 à 70 kg de lavandin pour obtenir un litre d’huile essentielle contre 100 à 120 kg de lavande officinale. Vous comprenez pourquoi les lessiviers l’ont adopté !
Les propriétés de l’huile essentielle :
- Antispasmodique puissante, décontractante musculaire, relaxante, calmante, sédative ****
- Antalgique, anti-inflammatoire ***
Les indications :
- Crampes, contractures musculaires, spasmes nerveux
- Anxiété, nervosité, insomnie
- Affections cutanées (plaies, escarres, ulcères, brûlures, dermatoses allergiques et infectieuses)
Les utilisations :
- Voie buccale : +
- Voie cutanée : +++
- Diffusion : ++ (15 min)
Les recettes :
– Crampes musculaires : 5 gouttes d’HE Lavandin + 2 gouttes d’HE Bois de Rose + 2 gouttes d’HE Romarin officinal 1,8 cinéole dans 1 c. à café d’HV Macadamia. Appliquer quelques gouttes du mélange en massage sur la zone douloureuse.
– Préparation sportive : quelques gouttes en friction avec de l’HE de Romarin officinal 1,8 cinéole dans 1 c. à café de baume de Copaïba.
– Préparation au sommeil : en diffusion 15 min avant le coucher dans la chambre.

La mauve
Vous avez sûrement déjà rencontré la fleur de mauve dans de nombreux mélanges pour tisane. C’est d’ailleurs l’un des remèdes les plus populaires pour soigner la toux et les maux de gorge.
Sa tisane réserve aussi des surprises hautes en couleur.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, la mauve est à la fois laxative et anti-diarrhéique !
C’est la magie des mucilages ! Au contact de l’eau, ils gonflent pour former un gel qui favorise le transit intestinal en cas de constipation. Mais en cas de diarrhée, ils sont aussi capables d’absorber l’excès de liquides intestinaux.
En infusion pour les inflammations :
En dehors du système digestif, la mauve est recommandée pour tous types d’états inflammatoires, et notamment pour soulager et réparer les muqueuses irritées de la gorge. La médecine populaire l’utilise depuis longtemps pour apaiser la toux, l’asthme, les angines, bronchites, laryngites et trachéites. En cas de cystite ou de calculs rénaux, elle protège également les tissus du système urinaire.
Vous pouvez aussi faire un usage externe de son infusion pour calmer les inflammations de la peau, de la bouche ou des yeux. Dans ce cas, appliquez simplement l’infusion refroidie en compresses sur la paupière fermée comme cela se pratique avec la camomille ou le bleuet. Autrefois, on employait même le suc frais de la plante directement sur les piqûres de guêpes.
Pour réussir votre infusion, veillez à ne pas la faire monter à trop haute température, car les mucilages sont détruits par la chaleur. Comptez une bonne pincée de fleurs et/ou feuilles de mauve séchée pour 150 ml d’eau froide. Faites chauffer doucement jusqu’à atteindre 60 à 80 °C. Surveillez votre casserole : dès que des petites bulles commencent à remonter du fond, retirez du feu puis laissez infuser 10 minutes à couvert.
La tisane des apprentis sorciers :
Les enfants adorent l’infusion de mauve car elle change de couleur comme par magie. Il suffit de quelques minutes pour voir sa jolie teinte bleutée tourner au vert. Voilà comment on transforme une tisane de Schtroumpf en potion de Shrek !
Et si vous voulez jouer les alchimistes, ajoutez quelques gouttes de jus de citron dans votre infusion bleue pour la faire passer au rose. Le secret, c’est le changement de pH, mais ne le dites à personne…
Usages médicinaux de la mauve (en résumé) :
- Anti-inflammatoire : cette action est plutôt dirigée vers le système urinaire, surtout si la mauve est utilisée en association avec la Bruyère officinale et l’Aspérule odorante.
- Antitussif : les principes adoucissants contenus dans l’infusion calment les toux d’irritation.
- Émollient : c’est un adoucissant des irritations des muqueuses internes dont l’action est notable, notamment sur les toux et les entérites.
- Laxatif : doux, il est à utiliser chez les enfants, les personnes âgées et fragiles.
- Vulnéraire : en usage externe, à base d’infusion de fleurs mauves pour nettoyer les petites plaies et stimuler leur cicatrisation.
Étant limité en nombre de pages de ma newsletter, je traiterai ultérieurement les autres plantes.
Portez-vous bien !
Jean-Pierre Willem
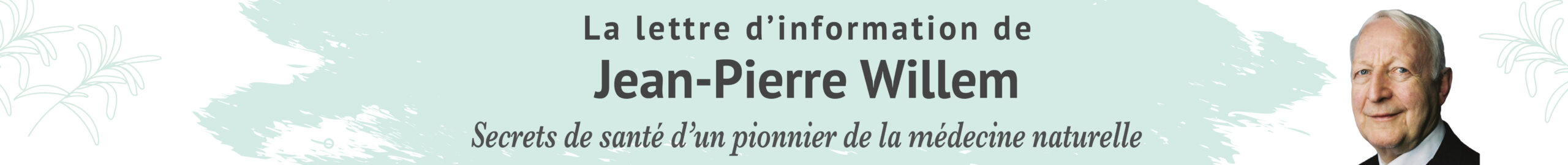


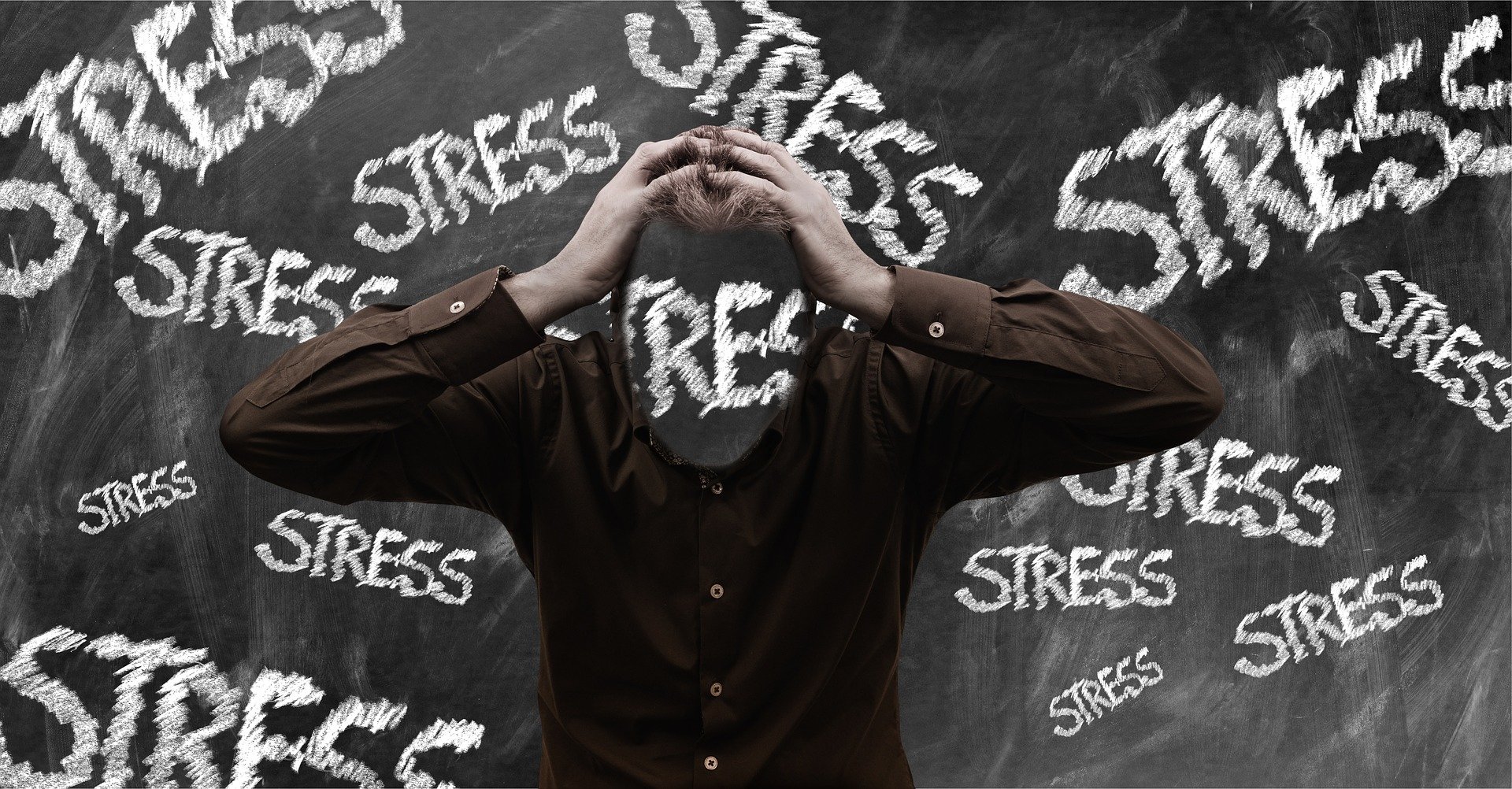

Merci beaucoup
bonjour
Hypertrophie bénigne de la prostate : svp comment diminuer la progression de la prostate
j’aimerai abaisser le niveau de la PSA j’ai 82 ans a L’IRM rien mais la PSA augmente
pourquoi
Amicalement merci