Chers amis,
La panacée désigne le remède universel à toutes les maladies. Quel est ce fameux remède qui va nous débarrasser de nos souffrances quotidiennes ?
L’alimentation cétogène, également connue sous le nom de « keto » (abréviation de Ketogenic Diet), consiste en une forte réduction de l’apport en glucides, compensée par une augmentation significative de la consommation de graisses alimentaires.
Ce modèle nutritionnel modifie profondément le métabolisme énergétique de l’organisme, avec des visées thérapeutiques à la fois préventives et curatives.
Ainsi, les graisses deviennent un carburant alternatif !
Nous tirons notre énergie de notre nourriture et principalement de trois catégories d’aliments :
- les glucides : amidons (pomme de terre, riz, blé et autres céréales), sucre, fruits et légumes ;
- les graisses (ou lipides) : huiles, beurre, margarine, crème fraîche, noix ;
- les protéines : viande, volaille, poisson, œuf, laitages.
Notre alimentation comprend près de 50 % de glucides, 35 % de graisses et 15 % de protéines. À l’inverse, la diète cétogène est à chaque fois associée à un jeûne, comporte très peu de glucides, phénomène métabolique dû à l’apport presque exclusivement de graisses et de protéines (à la dose de 1 gramme par kg de poids corporel).
L’objectif étant de ne plus tirer notre énergie du glucose mais des graisses via les corps cétoniques. Dans la diète cétogène, l’alimentation doit compter environ 90 % de lipides, 8 % de protéines et 2 % de glucides.
A retenir :
On ne peut vivre sans manger au moins un peu de graisses et de protéines, mais on peut très bien vivre sans consommer de glucides.
Les cétones, un héritage préhistorique
Cette prouesse métabolique qui permet à notre cerveau de brûler des corps cétoniques quand il n’y a plus de glucose est parfaitement logique du point de vue de l’évolution. Nous n’aurions pas pu survivre sans les corps cétoniques.
En effet, imaginons la vie de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Certains jours, la chasse était fructueuse, les aliments étaient abondants. Mais d’autres jours, la nourriture se faisait rare. Nos ancêtres étaient confrontés à des famines épisodiques.
Le corps n’avait d’autre choix que de puiser dans ses réserves musculaires de glycogène ; mais avec l’équivalent de seulement 1 000 calories, impossible de tenir plus d’un jour ou deux.
C’est alors que la cétose se produisait. L’organisme puisait des triglycérides dans ses réserves de graisses, qu’il transformait en corps cétoniques. Les corps cétoniques prenaient le relais du glucose et alimentaient le cerveau pour assurer la survie de l’espèce.
Un carburant alternatif
Il consiste à consommer des graisses au lieu du glucose qui constitue la principale source d’énergie pour les cellules de l’organisme (tissulaires, musculaires, cérébrales, etc.).
Le glucose est issu de la dégradation des glucides alimentaires et stocké sous forme de glycogène, principalement dans le foie et les muscles. Cependant, ces réserves sont limitées et, une fois épuisées, il n’est pas rare de voir survenir fringales ou sensation de fatigue.
Le principe fondamental de la diète cétogène est de remplacer ce carburant glucidique par les graisses, forçant ainsi l’organisme à puiser dans un autre substrat énergétique.
Une fois la réserve de glycogène épuisée, le foie synthétise des corps cétoniques à partir des acides gras issus de l’alimentation ou des réserves adipeuses sources de graisses endogènes ou exogènes.
Ce processus, appelé « cétogenèse », permet de fournir une énergie stable et soutenue à toutes les cellules, celles des organes, des muscles et des tissus.
Pathologies améliorées ou guéries par la diète cétogène : Épilepsie, Diabète 2, Alzheimer, Parkinson, Cancer, VIH, Obésité.
L’épilepsie
Le régime cétogène est resté la norme en matière de soins des crises épileptiques jusqu’à ce que des médicaments efficaces soient développés à partir des années cinquante. Ils remplacèrent alors le régime cétogène.
Cependant, un certain nombre d’enfants présentaient toujours, malgré les traitements, des crises épileptiques. Dans les années quatre-vingt-dix, on a proposé de mettre sous diète cétogène les enfants réfractaires aux traitements médicamenteux. Le suivi de ces enfants a montré que plusieurs d’entre eux étaient nettement améliorés par cette diète.
On a également noté que les enfants présentaient moins d’effets secondaires en suivant la diète cétogène qu’en prenant des médicaments antiépileptiques. Par ailleurs, leurs résultats scolaires étaient meilleurs quand ils ne prenaient pas de médicaments.
Le diabète type 2
L’insuline est l’hormone que nous secrétons au niveau du pancréas lorsque le taux de sucre augmente dans le sang. L’insuline régularise le taux de sucre dans le sang pour le maintenir dans des bornes limites.
Dans le diabète de type 2, le pancréas sécrète de l’insuline mais les cellules n’arrivent plus à l’utiliser. Normalement, sous l’action de l’insuline, les cellules utilisent le glucose présent comme source d’énergie et stockent l’excédent sous forme de glycogène dans les cellules musculaires, les cellules graisseuses et les cellules du foie.
Dans le diabète de type 2, les cellules n’en sont plus capables, malgré la présence de l’insuline. Elles deviennent résistantes à l’insuline. Le sucre augmente alors dans le sang et les cellules du pancréas fabriquent davantage d’insuline, mais en vain.
À terme, le pancréas finit par s’épuiser et les personnes deviennent alors très assignées par les injections d’insuline. L’excès de sucre dans le sang, l’hyperglycémie, lèse les vaisseaux, tout particulièrement ceux au niveau des reins, du cœur, du système nerveux et du cerveau, et des vaisseaux aux yeux l’ensemble.
Des études sur des modèles de souris développant un diabète de façon spontanée ont montré le développement de lésions cérébrales du même type que celles de la maladie d’Alzheimer (apparition de protéine Tau phosphorylée et d’enchevêtrements neurofibrillaires). D’où l’hypothèse que la maladie d’Alzheimer serait une forme de diabète du cerveau. On parle de diabète de type 3.
On retrouve une résistance à l’insuline au niveau cérébral dans d’autres maladies neurodégénératives : maladie de Parkinson, maladie de Huntington, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, épilepsie. Ce phénomène se retrouve aussi dans les diabètes de type1 et 2.
Les effets biochimiques et métaboliques
La mise en place d’une alimentation cétogène s’accompagne de plusieurs adaptations métaboliques majeures :
- Baisse de l’insuline : hormone favorisant le stockage des graisses dont la sécrétion est stimulée par les glucides ;
- Activation du glucagon : hormone catabolique qui stimule la néoglucogenèse et la lipolyse ;
- Mobilisation des réserves adipeuses, en particulier de la graisse viscérale, qui est la plus pernicieuse, associée à divers risques cardio-vasculaires ;
- Stabilisation de la glycémie et du taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c), par conséquent, disparition des pics post-prandiaux responsables de somnolences ou de fringales sucrées ;
- Maintien de la masse musculaire, à condition qu’un apport suffisant en protéines soit assuré.
Ces ajustements hormonaux et métaboliques améliorent le profit glycémique (HbA1c), insulinémie à jeun, et soutiennent la combustion des graisses.
Soutenue par un nombre croissant d’études scientifiques, cette approche se révèle prometteuse pour un grand nombre de problématiques de santé : perte de poids par mobilisation des graisses corporelles, prévention de l’obésité, régulation de la glycémie et de l’insulinémie (diabètes de type 1, 2 et 3), réduction de l’inflammation de bas grade, troubles du spectre autistique, épilepsie, démence, pathologies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer, le cancer, VIH).
La maladie d’Alzheimer
Lorsque l’on observe l’activité du cerveau à l’aide d’un Pet-scan, on s’aperçoit que chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, le métabolisme du glucose dans le cerveau est anormal : il est ralenti par rapport à celui de personnes non atteintes.
Les chercheurs ont montré que la maladie d’Alzheimer s’accompagne d’une diminution de l’utilisation du glucose au niveau des cellules cérébrales. Cette diminution est de l’ordre de 20 à 40 % ! Or, le glucose est le premier aliment du cerveau.
La bonne nouvelle c’est qu’il y a une autre source d’énergie pour les neurones : ce sont les cétones. Grâce à la diète cétogène, on augmente le taux de cétones dans le sang. Une part de ces cétones est directement utilisable par les cellules du cerveau.
Lorsque les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer bénéficient d’une diète cétogène, on observe une amélioration de leurs performances cognitives et une diminution des troubles. Pour certains individus, l’évolution de la maladie est ralentie.
Pour d’autres, elle est même stoppée. Malheureusement, pour d’autres encore les effets sont modestes. Mais, il n’y a rien à perdre à essayer et tout à gagner !
De plus, les chercheurs ont montré qu’il existe un lien entre la maladie d’Alzheimer et le métabolisme du glucose. En effet, on retrouve dans la maladie d’Alzheimer :
- Une résistance des neurones à l’insuline,
- Une diminution de la capacité du cerveau à utiliser le glucose,
- Un lien épidémiologique avec la consommation de glucides : les gens qui mangent le plus de glucides ont un risque de démence augmenté par rapport à ceux qui en mangent moins.
Concernant les graisses, on retrouve un lien inverse. Les gens qui mangent le plus de graisses ont un risque de démence diminué par rapport à ceux qui en mangent le moins. Chez l’animal, la diète cétogène freine la maladie d’Alzheimer. On retrouve moins de protéine bêta-amyloïde dans le cerveau des animaux.
Le cancer
Le départ et l’évolution du cancer se caractérise par deux phénomènes. Il se nourrit de sucre (à savoir les glucides) et se développe en anaérobiose, il n’aime pas l’oxygène. Ainsi il faut lui fournir un excès d’oxygène. Le bol d’air de Jacquier fournit cet oxygène issu de la térébenthine. On peut louer cet appareil au labo Holiste.
La cellule cancéreuse est avide de sucre
Le régime Okinawa se caractérise aussi par de faibles apports en sucres, ce qui empêche le développement des cellules cancéreuses, contraintes de consommer du glucose pour compenser des défaillances de la respiration cellulaire ou les conditions d’hypoxie (déficit en oxygène).
Plus le cancer progresse, plus il devient littéralement « accro » au sucre et à l’ensemble des glucides à digestion rapide. En imagerie médicale (PET Scan), on se sert d’ailleurs d’un analogue radioactif du glucose pour pouvoir visualiser un cancer et ses éventuelles métastases !
La cellule tumorale a donc un point faible : son métabolisme énergétique. Elle dépend à ce point du glucose, son carburant principal, qu’elle réagira à la hausse rapide et brutale des taux sanguins de glucose en absorbant ces glucides, par l’intermédiaire de transporteurs spécifiques tel le GLUT1.
Ces transporteurs pourraient constituer une cible thérapeutique intéressante, à partir notamment de certains polyphénols comme la curcumine et la quercétine, capables d’inhiber l’activité de transport de GLUT1.
Le VIH
La faisabilité et l’efficacité du régime cétogène gagneraient à être sérieusement évaluées auprès des personnes séropositives, en particulier auprès de la grande minorité des patients ne répondant pas à leur traitement (persistance d’une faible charge virale), et chez les patients porteurs d’un virus résistant aux antirétroviraux.
Le terme autophagie vient du grec auto = soi et phagie = manger, soit « se manger soi-même ». L’autophagie aide la cellule à se nettoyer, se rénover et se défendre.
Il s’agit d’un processus cellulaire fondamental permettant d’éliminer et de recycler des composants intracellulaires, mais aussi de piéger et détruire des micro-organismes invasifs tels que virus et bactéries. Il s’agit de l’un des plus anciens mécanismes de défense contre les agents pathogènes intracellulaires ;
L’activité physique, la pratique du jeûne intermittent et une alimentation à la fois frugale et suffisamment riche en polyphénols (fruits, thé vert, vin rouge, huile d’olive extra vierge, curcuma, soja fermenté), oméga-3 EPA/DHA et vitamine D3 (poissons gras) contribuent à stimuler l’autophagie.
La perte de poids
Pour favoriser une perte de poids efficace, il est conseillé de viser, de façon générale, une composition des repas structurée autour d’environ 40 g de protéines, 35 g de graisses alimentaires et 10 g de glucides nets (hors fibres). Ce léger déficit énergétique favorise l’activation de la lipolyse (fonte des graisses).
L’assiette-type peut comprendre œufs, viandes et poissons gras, fruits de mer, légumes verts assaisonnés d’huile d’olive, noix, avocats, olives. Il est essentiel de manger à satiété, afin de ne pas ralentir le métabolisme de base, qui soutient les fonctions vitales (thermorégulation, respiration, circulation, activité cérébrale, etc.).
En complément, la réussite d’une diète cétogène repose sur un sommeil réparateur, une bonne gestion du stress et une activité physique régulière.
Au-delà de la gestion du poids, la diète cétogène influence positivement les mécanismes immunitaires et inflammatoires. Une alimentation contenant moins de 10 % de glucides favorise la production de lymphocytes T, cellules de l’immunité adaptative.
Des modifications positives de la composition du microbiote intestinal ont été observées, contribuant à la réduction de l’inflammation chronique. Cette modulation pourrait expliquer l’intérêt du régime dans la prévention ou l’accompagnement de maladies inflammatoires chroniques, voire de certaines pathologies neurodégénératives.
Stabilité énergétique
Un avantage souvent évoqué par les personnes suivant une diète cétogène est la stabilité énergétique. Contrairement aux glucides, dont la digestion entraîne des variations rapides de la glycémie, les graisses permettent une libération progressive de l’énergie et préviennent coups de pompe, fringales et autres variations d’humeur.
Une fois le régime cétogène adopté, la sensation de faim devient progressive, modérée et physiologique, sans comportement alimentaire compulsif, ce qui permet un bon confort corporel, notamment lors de l’activité prolongée : réunion ou encore randonnée, sans ressentir un besoin urgent de s’alimenter.
Adopter une alimentation cétogène implique un réajustement profond de tous les métabolismes, souvent accompagné de nouvelles sensations : une plus grande clarté mentale, une énergie durable, une absence de fringales et de somnolence après les repas.
La transition peut nécessiter plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tout nouvel équilibre requérant du temps, en l’occurrence celui de laisser l’organisme s’adapter pleinement à cette nouvelle voie métabolique.
Il convient enfin de rappeler qu’il existe différents degrés de cétose (modérée à stricte), et l’individualisation reste essentielle. L’approche mérite d’être expérimentée avec attention, de préférence sous supervision nutritionnelle ou médicale, surtout en présence de pathologies déclarées.
Diète cétogène améliorée
Si la diète cétogène permet d’obtenir de très bons résultats, il faut reconnaître qu’elle est très difficile à supporter sur le long terme. Ingérer d’importantes quantités de graisses chaque jour peut être très désagréable pour certains. C’est pourquoi, on peut recourir à une diète cétogène améliorée à base de triglycérides à chaînes moyennes (TCM).
Les triglycérides à chaînes moyennes (TCM) ont la particularité de produire davantage de corps cétoniques par kilocalorie que les triglycérides à chaînes longues. De plus, ces TCM sont absorbés de façon plus efficace et sont transportés directement dans le foie.
Enrichir son alimentation avec des TCM présente donc un énorme avantage : on peut obtenir le même taux de corps cétoniques qu’avec une diète cétogène classique mais en mangeant moins de graisses. Cela permet d’augmenter proportionnellement la quantité de protéines et de glucides et par conséquent de rendre le régime plus facile à supporter.
Les triglycérides constituent la plus grosse partie des graisses que nous absorbons : 98 %. Le reste des graisses est constitué de cholestérol, phospholipides, vitamines liposolubles (A, D, E, K). Pour passer dans le sang, les molécules de triglycérides doivent être coupées en petits morceaux grâce à des enzymes appelées lipases.
Les lipases proviennent des glandes salivaires et surtout du pancréas. Il faut ensuite l’action des sels biliaires pour que les graisses soient résorbées dans le tube digestif.
Les TCM libèrent rapidement dans le tube digestif les acides gras à chaînes moyennes (AGCM) et passent donc plus rapidement dans le sang pour apporter plus rapidement de l’énergie aux cellules. Ils entrent alors dans les cellules où ils sont oxydés, les acides gras entièrement oxydés, produisent des corps cétoniques, lesquels deviennent producteurs d’énergie au niveau des cellules à la place du glucose.
On trouve des triglycérides à chaînes moyennes naturellement dans la matière grasse du lait de vache donc dans le beurre (9 % environ), mais surtout dans l’huile de noix de coco. Cette huile végétale est la plus riche en TCM, elle en renferme près de 60 % !
L’huile de noix de coco
L’huile de noix de coco est extraite de la chair de la noix de coco, selon différents procédés : soit par pression, soit par centrifugation. C’est une huile très riche en graisses saturées, ce qui explique qu’elle est solide à température ambiante. Elle contient environ 60 % de triglycérides à chaînes moyennes.
Elle ne contient pas de cholestérol ni d’oméga-3 et quasiment pas d’oméga-6. La fraction restante se compose d’acides gras mono-insaturés, 11 % d’acides gras à chaînes longues. Ce sont les acides gras saturés C8, C10, C12 qui forment, dans l’huile de noix de coco, les triglycérides à chaînes moyennes.
Elle est utilisée quotidiennement au Sri Lanka, en Indonésie, aux Philippines et dans les îles du Pacifique Sud. Dans toutes ces populations, la mortalité et la fréquence des maladies cardio-vasculaires sont faibles.
Il est vivement conseillé de recourir à une huile biologique, n’ayant pas subi de traitements par la chaleur ou l’ajout de produits chimiques. Notons que beaucoup d’huiles de noix de coco sont raffinées, l’huile de coco est extraite à l’aide de solvants et à des températures élevées. On peut utiliser l’huile de noix de coco directement dans les aliments ce qui ajoute un bon goût de noix de coco.
L’huile de noix de coco peut remplacer progressivement les autres types d’huiles, tels le beurre ou les margarines. On peut donc l’utiliser en cuisine même si on monte en température car elle est très stable à la chaleur. Toutefois ne pas dépasser la température de 100°C.
Rappelons que l’huile de noix de coco manque d’acides gras essentiels oméga-6 et oméga-3 qu’on peut trouver dans l’huile de colza, les noix, les graines de lin, les poissons gras.
À l’introduction de l’huile de noix de coco dans votre alimentation, il peut y avoir apparition de nausées, vomissements, constipation ou diarrhée, parfois également des crampes. Il faut donc introduire l’huile de noix de coco progressivement. Commencer par une cuillerée par jour pendant quelques jours, puis augmenter progressivement la dose en ajoutant une cuillerée tous les trois jours, pour arriver entre 35 et 40 grammes sur la journée.
La consommation d’huile de noix de coco de qualité fait baisser le taux de cholestérol total et augmente le bon cholestérol (HDL).
En conclusion, l’utilisation d’une huile de noix de coco de qualité, extraite de noix de coco bio sans chauffage et sans ajout de produits chimiques garantit une bonne santé cardio-vasculaire, et restaure l’ensemble des appareils (digestif, respiratoire, cutané, ORL…).
Portez-vous bien !
Jean-Pierre Willem
N.B : Pour plus d’informations, voir mon livre Pollution et Santé Ed. Dangles
- Alimentation moderne, les additifs, les OGM, la cuisson ;
- La pollution environnementale (électrosensibilité, métaux lourds, nanoparticules, vaccin, tabac) ;
- Effondrement des 5 barrières protectrices ;
- Le régime crétois, le régime Okinawa, le régime hypotoxique du Dr Jean Seignalet, le bol d’air de jacquier, le jeûne ;
- Les limites de la médecine officielle ou allopathie ;
- Les avantages des médecines de terrain.
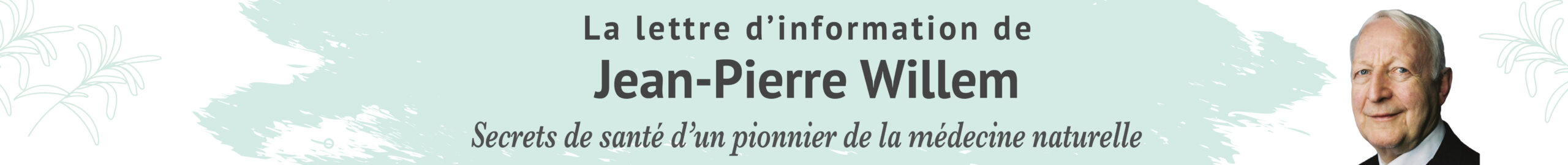





Article du docteur Willem très intéressant . Pas avare de ses connaissances , clair . Merci infiniment
bonjour,
j’ai lu attentivement votre message sur la diète cétogène.
j’ai donné un rein a mon ami a qui on a retiré les 2 reins qui avaient de gros kystes. d’ailleurs il semble qu’un nouveau kyste réapparaissent.
Pouvons-nous appliquer ce régime? n’est-il pas trop riche pour notre rein restant ?
merci de votre réponse.
Amicalement
Christine Martin